🏭 Infrastructure | Cybernetruc #16
Fin du Net, où on commence par parler d'infrastructure et où on invoque William Gibson, François Truffaut et Genpei Akasegawa. Mais surtout, on s'entretient avec Sylvain Grisot, urbaniste circulaire.
Cybernetruc continue d’explorer nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes pratiquement deux cents à suivre cette aventure. Bonne lecture !
Des [🎥], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers des compléments d’information.
🌉 San Francisco Bay Bridge
Dans Lumière Virtuelle [📘] – Virtual Light dans sa version originale sortie en 1993 – l’inventeur du Cyberpunk William Gibson [📄] décrit l’un des futurs possibles de la ville. Que ce soit une ville totalement livrée aux intérêts privés et à l’appétit sans-fin des multinationales, comme le sont Tokyo ou Los Angeles dans le roman, ou la ville livrée à elle-même entre ghettos et quartiers auto-gérés comme il imagine San Francisco quelques années après un grand tremblement de terre.
C’est à San Francisco que se déroule la plus grande partie du roman, et plus précisément autour du San Francisco Bay Bridge [📄]. Faisant écho au tremblement de terre de 1989 [📄], Gibson imagine un univers dans lequel ce pont est devenu impropre à la circulation, remplacé par une série de tunnels construits en un temps record par des robots. Ayant perdu son usage premier, le San Francisco Bay Bridge n’est pas détruit pour autant : il sert de refuge à de multiples populations de la ville, démunis et précaires pour la plupart, qui y établissent leur logement à la façon d’un bidonville suspendu. On retrouve là l’imaginaire des ponts bâtis du moyen-âge européen [🖼]. Gibson l’explique : le pont est devenu un thomasson.
Mais qu’est-ce exactement qu’un thomasson ?
Le mot dérive du nom d’un joueur de baseball américain : Gary Thomasson [📄]. Joueur star des ligues américaines dans les années 1970, il quitte les États-Unis pour le Japon en 1981, recruté à prix d’or par les Yomiuri Giants. Mais voilà, Thomasson s’adapte mal au style de jeu japonais. En une saison, ses statistiques s’effondrent et malgré l’argent investi par le club pour son recrutement, le joueur star reste la plupart du temps sur le banc des remplaçants. Gary Thomasson devient une sorte de décoration de luxe, et s’il porte encore le maillot de son équipe, il ne joue plus.
Il a, comme le San Francisco Bay Bridge de William Gibson, perdu son usage.
On doit l’usage du terme thomasson à l’écrivain japonais Genpei Akasegawa [📄] qui l’utilisera pour désigner tous ces petits bouts de bâti urbain qui ont perdu leur fonction lors d’un réaménagement de la ville : escalier ne menant plus à aucune porte, portail placé dans une rue ouverte, bretelle d’accès ne menant à aucune route.
Pont ne permettant plus de traverser la moindre baie.
🔄 Aparté. Tiens, on se poserait la question : est-ce qu’un mot désignant un objet qui n’existe plus, qui n’est plus en usage, est lui aussi une sorte de thomasson verbal ?
Je vous laisse réfléchir à ça.
⚒ Démantèlement
Cette métaphore du thomasson ouvre de nombreuses questions dans la persperctive d’une fin des outils numériques. Et notamment : que deviendraient alors les vestiges de nos infrastructures numériques actuelles ? Pour envisager un début de réponse, on pourrait étudier la question sous deux angles. Le premier, c’est d’observer la façon dont sont préservées, recyclées ou démantelées nos anciens systèmes de communication. Les exemples ne manquent pas…
Le réseau de la poste pneumatique de Paris [📄] – magnifiquement filmé par François Truffaut dans Baisers Volés [🎥] soit dit en passant – couvrait à son apogée plus de 427km et permettait d’envoyer en mode express un pli d’un bout à l’autre de la capitale. Mal entretenu et finalement assez désuet, son exploitation a cessé en 1984, remplacé par d’autres services proposés par La Poste. Mais son infrastructure physique existe toujours, du moins en grande partie. Si les postes de départ ou de réception des plis ont été démontés, les tubes eux-mêmes sont toujours présents dans les égouts de Paris. Où, il est vrai, ils ne gênent finalement pas grand monde.
Parce que c’est finalement rare qu’on démonte une infrastructure quand celle-ci est invisible, et surtout que son démantèlement représente un coût supérieur à son non-entretien. Un autre exemple ? La voie d’essai de l’aérotrain qui surplombe encore sur quelques kilomètres la plaine de la Beauce [📄], et qui, en dehors de l’emprise d’un chantier d’autoroute en 2007, est aujourd’hui quasiment-intacte.
Nos Data Centers et antennes 5G pourraient donc bien, en cas d’abandon des technologies numériques, ne devenir que de superbes ruines livrées à l’Urbex comme le sont de nombreuses usines ou les centres commerciaux des villes moyennes américaines [📰].
Pourtant, des infrastructures de communication qui disparaissent, il y en a. Deux exemples récents ? Allons-y. D’abord, les cabines téléphoniques [🎥]. En 1998, il y en avait 241 000 opérationnelles en France, que l’essor du téléphone mobile a peu à peu rendu obsolètes. Elles ne seraient plus que 4 aujourd’hui (en octobre 2023), suite à différentes réformes, lois et directives les excluant des contraintes imposées à France Télécom/Orange quant à l’accès universel aux télécommunications [📄]. Mais que devient une cabine téléphonique en fin de vie ? Hors quelques spécimens réutilisées comme bibliothèque publique ou exposés dans des musées des télécommunications, ces cabines sont en général envoyées à la casse et recyclées pour servir à la fabrication d’autres infrastructures.
Deuxième exemple, le réseau cuivré d’Orange (ou Boucle Locale [📄]), et là… c’est plus compliqué. Théoriquement, le réseau doit être entièrement désactivé à l’horizon 2030, date à laquelle il devrait être intégralement remplacé par un réseau fibre-optique. Rien n’empêchera donc Orange d’en opérer un démontage physique complet, ne serait-ce que pour en recycler le cuivre. Une estimation rapide ? Ses plus de 900 000 tonnes de cuivre représentent – les études varient – environs 9 milliards d’euros de matière première [📰]…
Mais l’exercice n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît : il reste bien entendu quelques lignes aériennes que l’on peut simplement décrocher, mais que faire du réseau souterrain quand il passe sous une autoroute ou une LGV, quand il traverse des zones protégées ? Orange récupérera bien entendu une partie de son trésor cuivré, mais de nombreux vestiges en subsisteront…
🔄 Aparté. Tiens, il faudrait relire et revoir ces quelques classiques de la science-fiction dans lesquels subsistent de grands vestiges des civilisations technologiques. Même si au final, les monuments symboliques ont bien plus d’impact dans nos imaginaires. Nous avons tous été marqués par l’apparition de la Statue de la Liberté à la fin La Planète des Singes [🎥]. Oups, spoiler.
♻ Recyclage
Alors, si on ne démonte pas – trop cher ou pas écolo – et si on n’est pas décidé à laisser derrière-soi un champ de ruines, que peut-on faire ? On peut toujours recycler, c’est à dire réutiliser les vestiges de notre civilisation numérique pour d’autres usages.

Le recyclage urbain, ce n’est pas nouveau. Les usines sont devenues des bureaux depuis de nombreuses années [📄], quand elles ne se transforment pas en école ou en logement [📄]. D’ailleurs, notre société numérique n’a pas attendu pour se réapproprier nos anciens bâtiments et les transformer en artefacts technologiques. Même si la démarche reste anecdotique – contraintes techniques obligent bien souvent – on trouve des églises [📄], des abris antiatomiques [📄], des silos à sucre [📄] ou encore des bunkers [📄] transformés en data center. Preuve que le recyclage est possible.
🚧 Maintenance
Réutiliser les infrastructures pour d’autres usages, c’est l’une des bonnes pratiques de ce que Sylvain Grisot – urbaniste et fondateur de dixit.net [💻], une agence de conseil et de recherche urbaine – nomme l’urbanisme circulaire : un principe de fabrique de la ville qui permet de limiter l’étalement et l’impact écologique de celle-ci [📄].
🔄 Aparté. Au passage, le dernier livre de Sylvain sur l’adaptation des territoires et de la ville – Redirection Urbaine [📕] – vient de sortir.
Alors, une question : si demain notre architecture numérique s’effondre, que deviendra son empreinte : des ruines ou de nouveaux lieux de vie, des carrières ou des symboles ? Et plutôt que de m’interroger seul, j’en ai discuté avec Sylvain Grisot, justement.
Et l’entretien a pris une tournure… inattendue.
🎙 On passe donc en mode interview…
Cybernetruc : Qu’est-ce que ça t’inspire tout ça ?
Sylvain Grisot : Tout de suite, j'ai envie de me décaler un peu en lisant tes réflexions.
Ce dont tu parles, l’infrastructure numérique, ce n’est jamais qu'une infrastructure urbaine. Et aujourd’hui, on associe souvent ces infrastructures à une logique de permanence. C'est à dire que dans notre imaginaire, elles sont là, elles ne bougent pas jusqu'à leur obsolescence. Mais ce que l'on ne réalise pas, c'est l'impermanence de ces infrastructures.
On les considère comme mortes. Or les infrastructures ont une vie. Elles ont à la fois une naissance, elles vieillissent, donc elles se dégradent, et elles meurent. Et tout ça parfois très vite.
Cybernetruc : Très vite, ça veut dire quoi ? L’image du vieux datacenter intact dans la jungle, comme une pyramide inca, ça n’a pas de sens pour nos infrastructures actuelles ?
Sylvain Grisot : Aujourd’hui, à partir du moment où on décide d'abandonner une infrastructure, vingt ans plus tard il n’y a plus rien.
Je caricature peut-être un peu, mais on ne doit pas en être loin pour les bâtiments les plus récents. Il y a l’eau déjà, tout simplement, qui s’infiltre par le toit. Si on les abandonne, les bâtiments les plus récents vont s'effondrer très vite. Et c’est normal : les choses ont une vie et naturellement, les infrastructures se dégradent.
Cybernetruc : D’où l’importance de la maintenance, même si elle est souvent invisible pour les utilisateurs ?
Sylvain Grisot : Oui, nos infrastructures demandent un entretien régulier. On parle bien sûr des ouvrages d'art, mais également des infrastructures numériques : réseaux, enrobés… Et même au-delà de la fibre et du câble, il y a également tous les équipements techniques qui permettent les connexions et interconnexions qui eux aussi vieillissent. Cela demande des réparation, des transformations, des modifications. De la maintenance.
Cybernetruc : La dégradation rapide des infrastructures dont tu parlais, elle ne va pas s’arranger du fait du changement des conditions climatiques, c’est ça ?
Sylvain Grisot : Effectivement, le changement climatique est lui aussi un facteur d’accélération de cette dégradation.Un exemple parlant, c’est celui de New-York.
Après l’ouragan Sandy, la ville s’est organisée et a investi des centaines de milliards de dollars pour faire face aux risques d’ouragan, avec des pluies importantes, brèves et soudaines. Sandy n’était que la deuxième forte inondation que subissait New-York. La précédente devait dater de 2, 3 ans auparavant. C’est à ce moment qu’on a pris conscience de la fragilité de la ville par rapport à l'eau. Et qu’on a pris conscience également que tout cela ne pouvait pas toujours être prévu.
De telles précipitations n’étaient pas listées dans les abaques – les tables de calcul utilisées pour estimer l’impact des précipitations. Elles étaient en dehors des référentiels et se sont abattues sur un territoire en fait complètement imperméabilisé. On sait gérer les afflux d’eau, même si c’est une ingénierie complexe. Sauf que là, l'événement de référence utilisé datait de plus d’un siècle. L’infrastructure n’était plus adaptée.
Le changement climatique, ça veut dire cela : plus d’évènements imprévus, extrêmes et des référentiels qui changent énormément. Et donc une maintenance, une adaptation forcément plus complexe des infrastructures, quelles qu’elles soient.
Cybernetruc : Si on aborde un autre point, il y a la question du recyclage des infrastructures numériques…
Sylvain Grisot : Là aussi, la question est complexe. On parle de “mines urbaines”, et je trouve le terme très bien choisi. Aujourd’hui, dans les mines traditionnelles, il commence à y avoir des difficultés d'extraction, c'est à dire que les taux de dilution sont plus importants qu’il y a 20 ans. En extraire des métaux comme le cuivre, à quantité égale, demande de plus en plus d’énergie.
C’est la même chose pour le recyclage. On peut rêver de la “mine urbaine”. Mais il y a là aussi un tel niveau de dilution des matériaux, de complexité d'accès, qu’à un moment cela n'a aucun sens d'un point de vue économique, mais sans doute aussi d'un point de vue environnemental. Les dégâts causés par l’extraction des matériaux souterrains, en ville par exemple, seraient par trop considérables.
Cybernetruc : Et du côté des bâtiments ?
Sylvain Grisot : Pour les bâtiments, on a deux solutions connues, maîtrisées. La première, c’est de faire du réversible, c'est à dire faire aujourd'hui des bâtiments qui demain pourront changer d'usage, se transformer en entrepôt, en logement, en autre chose. Aujourd'hui, ce n’est pas vraiment la voie qu'on prend. On préfère souvent faire de l’hyper spécifiques.
Sinon, on peut aussi faire du démontable. Ce qui n’est pas malsain. On fait par exemple des parkings silos qui ont des structures en acier démontables. Mais aujourd'hui, on préfère souvent construire du lourd, alors qu'on va souvent constater une obsolescence rapide des bâtiments.
OK. On oublie donc ces grands symboles de notre société numérique, tels que pouvait les rêver une certaine science-fiction, mais également – en l’état actuel du monde – le recyclage de nos infrastructures actuelles pour la société technologique du futur.
Reste quoi ?
🌘 En veille
Une troisième voie, évoquée en filigrane tout au long des échanges avec Sylvain Grisot : la maintenance. Une troisième voie qui rejoint, elle aussi, un certain imaginaire. Celui, non pas d’un effondrement mais plutôt d’une décroissance choisie et d’un abandon volontaire de certaines technologies. On rejoint par là l’imaginaire Solarpunk [📗] qui fait beaucoup parler de lui en ce début d’année. Et une certaine science-fiction des années 70 également, comme celle de Michel Jeury [📄].
On ressortira par exemple ce vieux classique de la SF française que l’on aime particulièrement : Les Écumeurs du Silence [📘] dans lequel la technologie abandonnée temporairement, le temps de laisser une Terre surexploitée pendant des siècles se reconstituer. Sur cette version de la Terre où les élites se sont réfugiées, endormies, dans les profondeurs, une partie du peuple est restée à la surface avec pour mission de veiller sur les anciennes infrastructures technologiques, jusqu’aux jours où le progrès humain pourra reprendre son cours.
Je ne spoile pas.
Laisser la planète se reposer, mais également préserver la technologie d’hier pour mieux préparer l’avenir. Et après tout, pourquoi pas.
Je vous laisse gamberger là-dessus ?





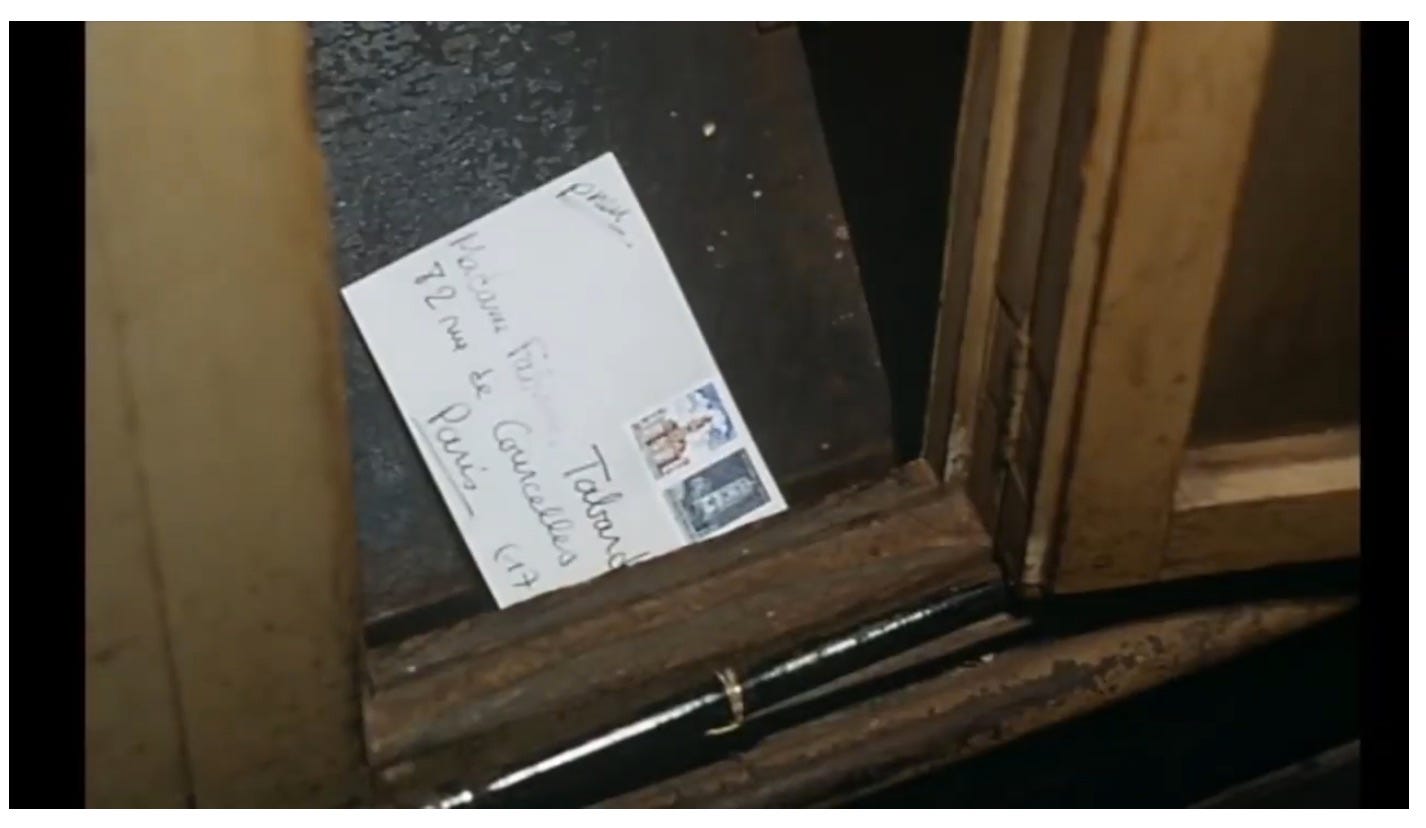

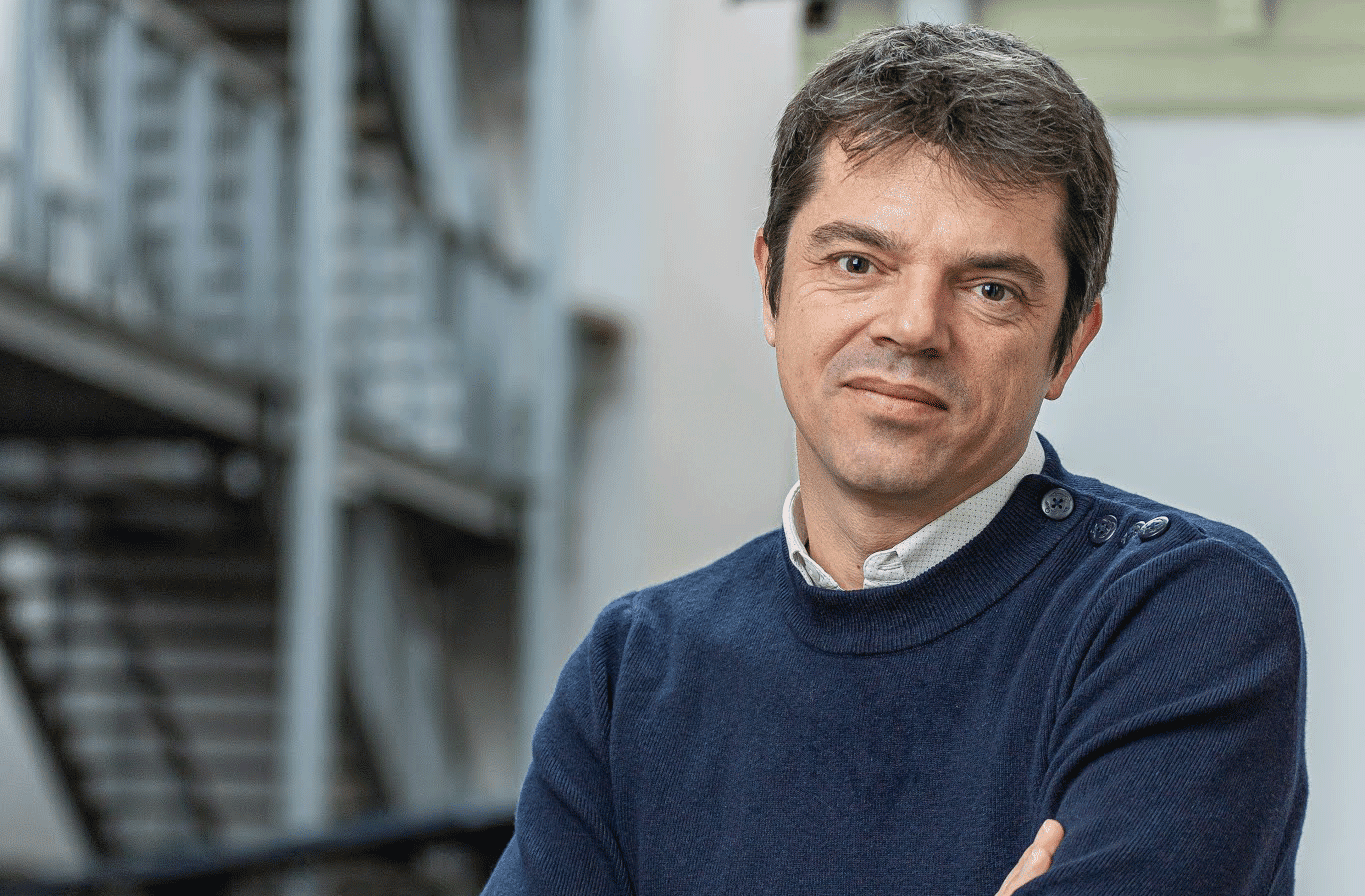
![Les écumeurs du silence - Michel Jeury - Fleuve Noir Anticipation 1980 [BE] | eBay Les écumeurs du silence - Michel Jeury - Fleuve Noir Anticipation 1980 [BE] | eBay](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!q_Yi!,w_1456,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F59ec5635-e476-47b3-8837-c65c9b62e55a_866x1418.jpeg)
Sur la question du « recyclage » des infrastructures je te recommande les travaux d’Alexandre Monnin https://reporterre.net/Capitalisme-les-impasses-de-la-redirection-ecologique