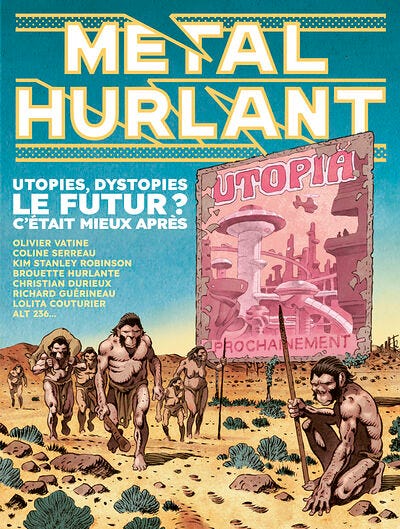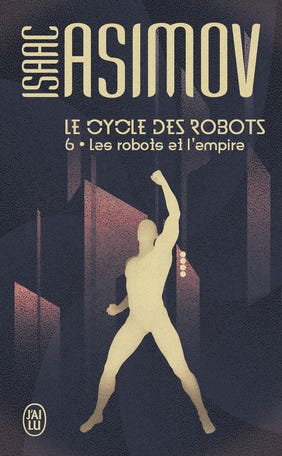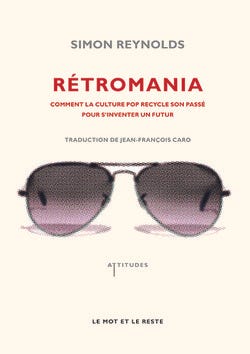🚀 Nostalgie | Cybernetruc #17
Si on parlait de nostalgie et de la façon dont elle irrigue nos imaginaires technologiques ? En invoquant cette fois Peter Fonda, Claude Sautet, André Courrèges et encore Metal Hurlant.
Cybernetruc continue d’explorer nos imaginaires technologiques et numériques. À chaque billet on divague, on imagine et on n’a pas forcément les réponses. Vous êtes désormais plus de deux cents vingt à lire cette aventure. Bonne lecture !
Des [🎥], [📗] ou [📰] ? Cliquez, ils vous emmèneront vers de petites madeleines ou des compléments d’information.
🌄 Utopie
Tout cela démarre par une lecture : Solarpunk [📗]. Un recueil de quelques nouvelles, premier ouvrage édité par Copie Gauche [💻], un éditeur normand qui entend défendre une approche raisonnée et responsable du monde de l’édition. Solarpunk entre dans la mouvance récente du Hopepunk, de l’utopie, de la science-fiction positive : un courant littéraire qui s’oppose ouvertement aux dystopies traditionnelles de la SF – et de son composant le plus emblématique, le Cyberpunk [🎥] – pour dépeindre un monde dans lequel les relations entre l’homme et son écosystème, sa planète, sont apaisées. Si vous souhaitez des exemples concrets de romans qualifiables d’Hopepunk, allez donc voir du côté des Becky Chambers [📄] – dont, oui, le Psaume pour les recyclés sauvages [📙] fait un bien fou – et Kim Stanley Robinson [📄] – dont vous aborderez alors Le Ministère du Futur [📗].
La mouvance Hopepunk a fait énormément parler d’elle ces derniers mois. Simple effet de mode ou tendance de fond, ce type d’imaginaire positif ne laisse pas grand monde indifférent. À titre d’illustration, Metal Hurlant – le magazine de bandes dessinées et d’imaginaire français ressuscité il y a quelques années – y consacre son dernier numéro [📘] en posant cette question : le futur était-il mieux avant ?
Entre de nombreux récits illustrés, on trouve là une interview de Kim Stanley Robinson himself qui insiste sur la nécessité de faire émerger des imaginaires positifs, un dossier de Charles Knappek qui fait le tour des récentes publications du genre et une autre interview poil-à-gratter de Romain Lucazeau [📄] qui joue le rôle du bad cop de service. Pour lui, l’utopie est un pis-aller, la seule émotion littéraire/imaginaire possible passant par la description du cauchemar cyberpunk, dystopique, dérangeant et déroutant. C’est caricatural, oui. Mais Romain Lucazeau est manifestement au sommaire de Metal Hurlant pour ça.
Entre le besoin d’espoir et le besoin d’émotions, chacun choisira donc son camp.
🚀 Berceau
Mais revenons à Solarpunk. Parmi les cinq nouvelles du recueil, on retiendra tout d’abord la très belle description d’un Bangkok sous les eaux dans le Entre les décombres de Lucie Heiligenstein [📄], un aperçu humain et vibrant de ce que c’est de vivre, simplement vivre, dans le monde d’après le dérèglement climatique. Mais on s’interrogera surtout sur deux nouvelles : Révolution permanente, signée Loïc Buczkowicz et Transmissions de Colin Vettier [📄] ont un point commun. Elle décrivent un monde duquel la technologie n’a pas disparu mais où celle-ci sert désormais l’humanité et la préservation de nature de manière juste et équitable.
Ainsi, dans Révolution permanente, des zones interdites de la Terre dans lesquelles la nature reprend doucement ses droits sont surveillées par des robots et des intelligences artificielles chargés de veiller à leur équilibre. Dans Transmissions, la technologie est plus discrète et la vie décrite ressemble plus à celle d’une communauté hippie de la fin des années 1960 [🎥] – tiens, on y reviendra. Dans ces deux nouvelles, aux univers assez proches, le recours – retour ? – à une technologie responsable n’est dû qu’à seule raison : le départ pour l’espace de l’élite capitaliste de la planète. Celle-ci s’est embarquée à bord de fusées que l’on imagine gigantesques pour, au choix, aller exploiter les autres planètes et leurs richesses minières, ou échapper à la catastrophe climatique et attendre un temps que la Terre se régénère.
🔄 Aparté. L’élite qui s’isole pour échapper au chaos ? Décidément, on y revient souvent : Michel Jeury toujours dans ses Écumeurs du Silence dont on parlait dans le dernier numéro de Cybernetruc, ou Michael Moorcock dans son Navire des glaces [📘].
Un imaginaire de la fuite qui n’est pas sans rappeler – et je suis bien obligé d’y revenir – l’âge d’or de la SF américaine et les différents cycles d’Isaac Asimov, et notamment cette transition mise en scène dans Les Robots et l’Empire [📙] pour laquelle la destinée de l’Homme est de partir à la conquête de l’univers et d’y continuer son expansion, et pour cela de sacrifier lentement la Terre et toutes ses possibilités de vie. Tous les joueurs de Civilization [🎮] le savent bien : “La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau” (Constantin E. Tsiolkovski [📄]).
L’une des bases de ce Solarpunk est donc là : non pas dans l’abandon ou la modération de la technologie comme on pourrait le croire – encore, que chez Becky Chambers la notion de modération est plus présente – mais plutôt dans une conquête sans fin du progrès qui permettrait, fort heureusement, de finalement laisser un répit à la planète Terre, voire d’en faire un laboratoire d’expérimentation politique pendant que le progrès continue son chemin à travers les étoiles. Une sorte de version positive du futur long-termiste – et oui, de celui d’Asimov à quelques différences près – dans lequel la Terre doit périr pour que l’Humain perde enfin ses attaches et s’épanouisse dans la conquête de l’Univers. Ajoutez ici un air symphonique [🎺].
Ici, par le biais de cette technologie heureuse, on en arrive à se demander si ce Solarpunk ne serait pas, quelque part, la première incarnation d’une sorte de nostalgie du progrès.
Et cette idée de nostalgie mérite qu’on s’y attarde un peu plus.
🕶 Nostalgie
Pour parler un peu plus de Nostalgie, nous allons nous tourner vers Simon Reynolds [📄], journaliste et critique musical britannique, auteur d’une jolie petite bible nommée Retromania [📘]
Difficile de résumer tout le propos de Retromania en quelques lignes. Et pourtant, on va tenter le coup… Dans les plus des 400 pages de ce pavé, Simon Reynolds ne se pose qu’une seule question : au tournant des années 2000, est-ce que la musique a perdu toute créativité et n’est plus qu’un éternel regard nostalgique sur le passé ? Pour démarrer ce constat, il se base notamment sur différents mouvements technologiques autour de la musique : le piratage [💻] du début des années 2000 et à sa suite le streaming qui a mis à disposition de tout un chacun des sommes musicales colossales. Est-ce qu’aujourd’hui notre consommation musicale s’est détournée de la créativité ? Et est-ce l’industrie musicale elle-même a tournée le dos à cette même créativité pour ne voir que les bénéfices faciles de compilations à outrance ?
C’est bien entendu plus compliqué que cela. Dans le chapitre 6 de Retromania, Simon Reynolds essaie par exemple de savoir quand les mondes de la musique et de la mode ont cessé d’innover et à commencer à recycler, maladivement, les tendances du passé. Il situe cela à la charnière des années 1966-67, quand dans les rues de Londres les robes Courrèges et Paco Rabanne ont laissé la place aux vêtements chinés dans les marchés de Soho et de Carnaby Street. Citation :
« Au fil de l’exposition, je décelai une transition survenant vers 1966-67. Presque du jour au lendemain, la dimension futuriste s’évanouit intégralement. Ce tournant paraissait d’abord subtil, comme ce modèle de Mary Quant inspiré des tenues des gouvernantes de l’entre-deux-guerres. Mais l’avènement du psychédélisme vit les jeunes adopter un style étranger à la modernité et au monde occidental industrialisé. La grammaire de la mode de la fin des années soixante relevait soit de l’exotisme temporel (influences victoriennes, édouardiennes, des années vingt et trente), soit de l’exotisme géographique (idées prélevées au Moyen-Orient, en Inde ou en Afrique). »
À partir de cette date, l’auteur se livre à un voyage dans le temps pour identifier l’ensemble des signes de cette nostalgie qui va envahir petit à petit l’ensemble du paysage musical anglo-saxon : du Trad Jazz au Rare Soul, jusqu’à la vague rétro des années 80 et les reprises des morceaux sixties par Softcell [💿]. Et cetera. Et cetera.
L’ouvrage mérite largement d’être parcouru pour l’exploration sans faille de la musique qu’il est, et pour ce voyage à travers la nostalgie musicale qui évoque bien des choses.
🔄 Aparté. Tiens, pour compléter la question de la nostalgie musicale et de son marché, on pourra s’atteler à la lecture des derniers chapitres de l’histoire des Beatles par Frédéric Granier [📙]. L’auteur y détaille la façon dont s’est construit l’héritage, et surtout l’histoire désormais officielle des Fab’Four, gommant petit à petit Pete Best [📄] et Stuart Sutcliffe [📄] de l’iconographie officielle, et lissant les conflits et dissentions internes du groupes.
🏜 Espaces
Mais c’est quoi au juste la Nostalgie ? Le plus simple, c’est d’ouvrir un dictionnaire. Au hasard les Trésors de la Langue Française Informatisée [💻] disponible en ligne qui entre de multiples interprétations du terme nous lâche :
Regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on n'a pas eu(e) ou pas connu(e).
Et c’est là que cela devient intéressant : on peut très bien être nostalgique d’une chose que l’on n’a jamais éprouvé. D’un fantasme, d’une idée, d’un rêve ou d’une époque. La publicité par exemple le démontre très bien, faisant de la nostalgie un levier fort de sa narration. Un exemple : l’une des dernières campagnes du constructeur automobile Renault, pour son modèle Megane E-Tech.
Le film, assez long et qui a dû coûter son poids de lithium en droits divers, met en scène le conducteur d’une Megane E-Tech. Rien de bien fou. Mais attendez… Dans son périple de quelques minutes, ce conducteur va tout d’abord dépasser Peter Fonda et Denis Hopper, tous droits sortis d’une scène d’Easy Rider [🎥] – j’avais promis d’y revenir – et faire quelques kilomètres avec eux. Jusqu’à ce que ceux-ci s’arrêtent à une station-service pour faire le plein de leurs bécanes. Le conducteur Renault, lui, n’a pas besoin de faire le plein. Il roule en électrique, malin qu’il est. Ce qui lui permet de continuer sa route et de croiser un peu plus loin le chemin de Thelma et Louise [🎥], autres fameux personnages de road-movie américain. Elles aussi feront le plein plus loin, laissant Jean-Michel Renault profiter de cette liberté que seule une Renault Mégane E-Tech peut lui offrir. Grand espace. Désert. Packshot. Sourire nostalgique sur le visage du téléspectateur.
En séquence, cela donne cela :
Voilà donc à quoi ressemble la nostalgie publicitaire aujourd’hui. Et elle colle parfaitement à la définition retrouvée dans le TLFi : le regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on n'a pas eu(e) ou pas connu(e).
Car, convenons-en, peu des conducteurs actuels - et mêmes futurs - de Renault Megane E-Tech doivent avoir connu les grands espaces américains, les trips au LSD [🎥] ou Brad Pitt dans sa prime jeunesse [📰].
🔄 Aparté. De toutes façons, pour la publicité, les vieux, cela n’existe pas. Il n’y a que des Nolds [📰] ! Na !
💻 Internet
De là à se dire que l’on peut avoir de la nostalgie pour quelque chose qui n’a finalement jamais existé, il n’y a pas énormément de pas à franchir. Et c’est avec Lucie Ronfaut – toujours incroyablement pertinente – que nous allons franchir ces quelques pas.
Dans un numéro de sa lettre #Règle30 daté de l’automne dernier, Lucie Ronfaut évoque, entre autre, les fermetures successives des vieux services du Net (Omegle, Skyblog [💻], etc.) et la nostalgie qui accompagne souvent ces fermetures [✉]. Vous partagez certainement ces mêmes sentiments : le Web, quand même, c’était mieux avant, plus libre, plus drôle, moins politique, moins polémique etc.
La lettre alerte tout de même sur les déformations de la réalité dont nous pourrions être les victimes :
« À une époque où plusieurs sites que l'on a connus et aimés ferment ou se détériorent, il est logique de regretter un temps où l'on s'amusait davantage en ligne. Quitte à oublier les nuances de nos quotidiens connectés d'alors. Je pense beaucoup à ce sujet depuis mon enquête sur les Skyblogs, il y a quelques années. À cette occasion, on m'a raconté des histoires tendres d'adolescence faite de GIFs pailletés et de police arc-en-ciel. J'ai aussi (re)découvert des affaires de cyberharcèlement et de violence en ligne, à peine modérées par la plateforme. »
C’est le double problème de la nostalgie : elle est à la fois un miroir déformant – qui peut garantir que ses souvenirs sont d’une exactitude exemplaire ? pas même un ministre de l’Éducation Nationale [📰] – et est forcément partiale et subjective. Notre nostalgie est peut-être le reflet déformé d’une réalité qui n’a jamais existé, et qui n’a jamais été vécue par la majorité des personnes. Et de conclure de manière implacable :
« Dans tous les cas, la question n'est pas de se demander si c'était mieux avant, ou même si c'était pire, mais ce qu'on regrette vraiment. Un web plus petit et moins dominé par les grandes entreprises n'est pas une protection magique contre la toxicité. Un web étrange où l'on riait davantage implique de réfléchir à qui appréciait cet humour, et qui en était éventuellement victime. Un web plus libre, mais pour qui ? On peut reconnaître que la violence s'est aggravée et a muté avec les outils technologiques, et aussi qu'elle a toujours existé sous d'autres formes. Peut-être que ce qui nous manque, finalement, c'est une époque où personne ne nous demandait de réfléchir à ces sujets difficiles. »
Voilà en tout cas de quoi réfléchir aux pièges tendues par la nostalgie.
🔄 Aparté. On avait déjà abordé cette question, décidément passionnante, de la pluralité des Web, et de ce que vos souvenirs d’expériences en ligne peuvent ne pas être mes propres souvenirs, simplement parce que le Net n’est pas un tout mais une juxtaposition de multiples micro-communautés. C’était dans Il n'y a pas un web, il y a des Webs.
Mais revenons Solarpunk.
🚀 Fusées
La question des fusées dans une nouvelle de science-fiction est triviale. La SF se nourrit d’imaginaires, et l’exploration spatiale est un imaginaire populaire, vieux comme… au moins tout ça [📘]. Mais son utilisation dans un genre comme le Solarpunk ou le Hopepunk qui se veut porteur d’espoir est symptomatique. Symptomatique de la place qu’occupe toujours la technologie dans nos imaginaires.
On voit régulièrement ressortir sur le Web cette série de cartes illustrées des années 1900 mettant en scène ce qu’on imaginait alors être l’An 2000 : des aéronefs individuels, des téléphones augmentés du cinématographe, des robots jardiniers ou encore des femmes de ménage automatisées [🖼]. Des visuels accompagnés soit d’un commentaire sarcastique – du style On nous avait promis des voitures volantes… [📰] – soit d’une remarque candide sur l’inventivité humaine et son envie intarissable de progrès.
La vérité révélée par ces images est peut-être un peu plus triste que cela. Comme on fantasme toujours Claude Sautet [🎥] et sa société de copains, de fumeurs et e voitures sans ceinture – et pourtant, j’adore les films de Claude Sautet –, on continue de fantasmer les voitures volantes et les fusées. On continue en fait de fantasmer un progrès et une technologie qui n’a pas évoluée depuis les nouvelles d’Asimov, d’Arthur C. Clarke et l’âge d’or de le SF américaine, celle des années 1950. Regardez donc les derniers postes des ambassadeurs du métaverse, de l’intelligence artificielle ou de la conquête spatiale sur LinkedIn. Ne fleurent-ils pas bon l’atomic-age ?
Mais… comment appelle-t-on des personnes qui n’ont pas changé de rêves depuis plus de 70 ans ? Comment appellent-on des personnes qui ne savent pas adapter leurs espérances à la réalité qui les entoure, aux changements du monde, de notre environnement, de notre société, de notre planète ? Comment appelle-t-on des gens qui veulent toujours coloniser Mars en dépit des limites planétaires ?
Quel autre mot utiliser que : nostalgiques ?
Peut-être serait-il temps de réaliser que les nostalgiques, ceux qui vantent le retour à un modèle passé et refusent d’évoluer, ne sont pas ceux que l’on croit.
Je vous laisse gamberger là-dessus ?